Polémique ayant trait
aux expéditions polaires de l'amiral Byrd
I Introduction
Le 25/02/04, nous avons reçu de l'ami M. Hertzog toujours à l'affût d'un scoop historique, 3 articles parus dans le journal bien connu "Le Monde" qui remettent en cause les résultats de l'expédition de L'amiral Byrd qui affirme avoir atteint le PôleNord, le 9 mai 1926. Nétant pas qualifiés pour prendre position dans ce débat, nous nous contentons donc de présenter les textes en question et surtout ce que Byrd lui même en pense dans un ouvrage publié aux USA en 1935, et sorti en français en Août 1951.
Nous ne saurions pas, non plus, éviter dans cet article de mettre en exergue, la polémique instaurée au sujet du fameux carnet de bord attribué à cet amiral Byrd, concernant son vol vers le Pôle Sud, le 19 Février 1947 .
II Genèse de l'affaire
Voici donc ces textes, les couleurs étant évidemment de nous :
La reconquête aérienne du pôle Nord
ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 16.02.01.
HUBERT DE CHEVIGNY, premier pilote ayant atteint en ULM le pôle Nord magnétique (1982) et le pôle Nord géographique (1987), et Gérard d' Aboville, auteur des traversées en solitaire de l'Atlantique nord (1980) et du Pacifique nord (1991) à l'aviron, devraient tenter, début avril, de rallier le pôle Nord à bord d'un avion dépourvu d'électronique, en se guidant uniquement au soleil, à l'aide d'une montre et d'un sextant.
Ces conditions de navigation astronomique étaient celles de la première conquête aérienne du pôle Nord par l'amiral américain Richard Evelyn Byrd, le 9 mai 1926. Cette expédition privée, financée par Edsel Ford, John D. Rockefeller Jr et le New York Times avait fait de cet aventurier un héros national, décoré de la médaille d'honneur du Congrès américain avant de mener à bien cinq expéditions dans l'Antarctique entre 1928 et 1947.
L' "ERREUR" DE BYRD
Or les doutes suscités par cette expédition sont devenus certitude avec la découverte et l'étude récente du journal de bord par des scientifiques : Richard Byrd n'avait pas atteint le pôle Nord ! Parti de King's Bay (Spitzberg) l'aviateur, qui avait décelé une fuite d'huile sur son réservoir supplémentaire, avait renoncé à se poser au pôle où il aurait pu faire une estimation astronomique précise.
Il aurait fait demi-tour à quelque 200 kilomètres du but. Erreur d'estimation ou supercherie, car l'aventurier savait que le Norvégien Roald Amundsen, l'Américain Lincoln Ellsworth et l'Italien Umberto Nobile allaient partir en dirigeable pour atteindre le pôle, trois jours plus tard ? Richard Byrd a emporté son secret dans sa tombe en 1957.
Hubert de Chevigny a conçu pour cette expédition un avion monomoteur avec une capacité d'évolution à basse vitesse exceptionnelle afin d'atterrir ou de décoller sur de très courtes distances. Une table à cartes est installée dans l'habitacle. L'équipage, composé d'Hubert de Chevigny (pilote et navigateur), de Gérard d'Aboville (navigateur) et du Québécois Bernard La Ferrière (pilote et mécanicien) ne disposera pas d'assistance radio ou satellitaire, ni même de compas magnétique, mais seulement d'une montre et d'instruments optiques permettant une navigation astronomique.
Les instruments de positionnement et d'orientation sont réglés grâce à la montre. Le compas solaire donne le cap par rapport à l'ombre projetée de l'aiguille. Le dérivomètre, qui est un trou muni d'un rapporteur dans le plancher de l'avion, permet de chronométrer la vitesse par rapport au sol, et d'évaluer l'angle de dérive qu'il faut corriger au compas solaire. Un sextant avec horizon artificiel permet d'estimer la position en vol, mais des atterrissages seront nécessaires pour effectuer des visées plus précises avec un sextant classique.
" FENÊTRE CLIMATIQUE "
La meilleure " fenêtre " climatique se situe au mois d'avril. Le soleil, indispensable pour la navigation astronomique, fait sa réapparition au pôle Nord le 5 mars et cette zone est encore sous l'influence de l'anticyclone d'hiver qui la protège des vents violents qui, avec le réchauffement, disloquent ensuite la banquise. Les trois aventuriers devraient partir début avril des Trois Rivières (Québec) pour une approche de 4 000 kilomètres jusqu'à Resolute Bay (île Cornwallis).
Une météo favorable sur deux ou trois jours sera alors nécessaire pour tenter de rallier et de se poser au pôle Nord, distant de 1 500 kilomètres. " Ce n'est pas un remake de l'expédition de Richard Byrd qui était parti du Spitzberg, précise Hubert de Chevigny, mais une tentative dans des conditions de navigation similaires ". Et le Private-Explorer sera doté d'une boîte noire qui permettra au retour de vérifier la précision de son vol...
GERARD ALBOUY
Voici le second texte:
L'imposture de l'amiral Richard Evelyn Byrd
Le premier survol aérien du pôle Nord géographique par les Américains Richard Evelyn Byrd et Floyd Bennett, le 9 mai 1926, relève-t-il de l'imposture ? Des révélations de l'aviateur norvégien Bernt Balchen, confortées par l'étude récente de documents de vol, remettent en cause cet épisode de la conquête des pôles.
Premier explorateur au pôle Sud, le 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundsen est aussi le premier à tenter de rallier le pôle Nord par la voie des airs en 1925. Cette expédition, financée par l'Américain Lincoln Ellsworth, repose sur deux hydravions Dornier qui quittent le Spitzberg le 21 mai. Contraints de se poser à 200 kilomètres du pôle, les six " prisonniers de la banquise " mettront vingt-quatre jours avant de faire redécoller l'un des hydravions pour regagner le Spitzberg.
Amundsen et Ellsworth s'associent alors avec l'ingénieur aéronautique italien Umberto Nobile pour tenter de survoler le pôle avec le dirigeable Norge, mais Richard Evelyn Byrd, un officier de l'US Navy, entre dans la course, financé principalement par le constructeur automobile Edsel Ford. Les deux expéditions se côtoient à King's Bay (Spitzberg). Le 9 mai 1926, Byrd et son pilote, Floyd Bennett, décollent à bord du Josephine-Ford, un biplan trimoteur Fokker. Quinze heures et demie plus tard, ils sont de retour après avoir, affirment-ils, " survolé le pôle ". Le Norge décolle à son tour le 11 mai. Seize heures plus tard, l'équipage de douze hommes largue les drapeaux norvégien, américain et italien au-dessus du pôle. Le 14, il atterrit à Teller (Alaska).
LES SOUPÇONS DE BALCHEN
Byrd et Bennett sont décorés de la médaille d'honneur du Congrès. Grâce à cette notoriété, Byrd boucle une souscription publique de 400 000 dollars pour une exploration aérienne de l'Antarctique et le premier survol du pôle Sud. Avant de rejoindre le musée Ford, à Detroit, le Josephine-Ford effectue un tour des Etats-Unis. Bennett a pour copilote le Norvégien Bernt Balchen, pilote de réserve du Norge au Spitzberg. C'est à cette occasion que naissent les soupçons de Balchen. Il constate que la vitesse de croisière du Josephine-Ford ne dépasse pas 70 miles/heure (112 km/h). Or, pour effectuer le périple entre le Spitzberg et le pôle en quinze heures trente, l'avion aurait dû tenir une moyenne de 100 miles/heure...
Balchen est choisi par Byrd comme premier pilote de son expédition en Antarctique qui survole le pôle Sud le 29 novembre 1929. Entre-temps, le 24 avril 1928, Bennett meurt d'une pneumonie après avoir transporté des pièces de rechange pour le Bremen, posé en catastrophe sur l'île canadienne de Greenly après avoir réussi la première traversée de l'Atlantique est-ouest. Moins de deux mois plus tard, le 18 juin, Amundsen disparaît dans l'océan Arctique en tentant de porter secours à Nobile après le crash du dirigeable Italia.
Pourquoi Balchen a-t-il attendu de prendre sa retraite de colonel de l'US Air Force, en octobre 1956, pour tenter de rendre publics ses soupçons en écrivant son autobiographie ? " Je ne cherche pas à dénigrer Byrd mais à faire connaître ma certitude qu'il n'a pas atteint le pôle Nord lors de son vol en 1926, écrit-il. Je l'affirme pour deux raisons. D'abord, l'avion ne pouvait pas effectuer un tel vol en quinze heures trente et, deuxièmement, parce que Floyd Bennett me l'a avoué. " Héros national élevé au grade d'amiral pour avoir dirigé cinq missions en Antarctique entre 1928 et 1947, frère de Harry Byrd, sénateur, puis gouverneur de la Virginie, Richard Byrd aurait exercé de multiples pressions politiques et militaires pour dissuader Balchen d'attenter à son honneur. Byrd meurt en mars 1957.
DES ARCHIVES LIVRENT LA VÉRITÉ
Les affirmations de Balchen, décédé en octobre 1973, sont confortées par plusieurs études de scientifiques. " Le vent a commencé à fraîchir et à changer de direction juste après que nous avions quitté le pôle, et bientôt nous volions à plus de 100 miles/heure ", écrivait Byrd dans le livre racontant son aventure (Skyward, Knickerbocker Press, 1928). Après avoir étudié les relevés météo américains et norvégiens entre le 8 et le 10 mai 1926, Gosta Liljequist, professeur de météorologie à l'université d'Uppsala (Suède), affirme : " La totalité de l'Arctique était couverte par un anticyclone et des coups de vent de 40-50 noeuds (indispensables au Josephine-Ford pour dépasser les 100 miles/heure) sous cette zone de haute pression étaient hautement improbables. " Ce sont surtout les archives de l'explorateur, acquises en 1994 par le Centre de recherches polaires Byrd, dans l'Ohio, qui peuvent livrer la vérité. A défaut d'avoir rédigé un rapport de vol, l'aventurier avait pris des notes sur un agenda, rendant compte de ses observations et de sa communication avec son pilote. Certains chiffres ont été rectifiés a posteriori, et le plan de route ne fait état que de huit relevés de position au sextant à bulle. Après étude de ces notes, Dennis Rowlins, un expert américain en navigation polaire, a estimé en 1998 que Byrd a rebroussé chemin à environ 240 kilomètres du pôle à cause d'une fuite d'huile sur un réservoir annexe. Il affirme : " Byrd n'a pas atteint son but et devait en être conscient. " Premier homme au pôle Sud, Roald Amundsen serait aussi le premier à avoir survolé le pôle Nord.
GERARD ALBOUY
Et voici le troisième texte:
Le pôle Nord comme au temps des pionniers de l'aviation
ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 27.04.01
Soixante-quinze ans après le survol très controversé de l'Américain Byrd, Hubert de Chevigny, Gérard d' Aboville et Bernard Laferrière se sont posés à proximité du pôle Nord en utilisant des instruments de navigation astronomique similaires " Resolute is not the end of the world, but you can see it from here. " (Resolute n'est pas le bout du monde, mais d'ici vous pouvez l'apercevoir). Cette inscription sur un T-shirt résume l'histoire et la vocation de ce petit village inuit situé par 75 degrés de latitude sur le passage maritime du Nord-Ouest entre l'Atlantique et le Pacifique, bloqué par les glaces la majeure partie de l'année.
Ses deux cent dix habitants descendent, pour certains, des dix-sept familles d'Inukjuak (Nunavit) désignées par le gouvernement d'Ottawa et embarquées le 25 juillet 1953 sur le brise-glace C.D.-Howe pour " peupler " le Grand Nord et asseoir la souveraineté canadienne sur ces immenses territoires convoités par les Américains, alors en pleine guerre froide avec les Soviétiques. La moitié de ces exilés furent débarqués à Grise Fjord, sur la côte sud de l'île d'Ellesmere. L'autre moitié à Resolute au terme de ce grand voyage vers l'inconnu.
Un demi-siècle plus tard, Resolute abrite un centre de recherches scientifiques sur l'Arctique et sert de base incontournable pour les expéditions polaires. Plusieurs d'entre elles, dont deux françaises, cohabitaient à la mi-avril dans les deux hôtels du village. Après avoir traversé en solitaire Ellesmere à pied et à ski (1 500 km en quatre mois), Jean-Marc Périgaud a quitté Resolute Bay le 16 avec cinq compagnons tirant leur pulka, pour tenter de rallier à ski le pôle Nord magnétique distant de 600 km.
Le 23, c'était au tour d'Hubert de Chevigny, de Gérard d'Aboville et du Québécois Bernard Laferrière de partir à destination du pôle Nord géographique pour un vol de 1 700 km, effectué en navigation astronomique dans des conditions similaires à celles des pionniers de l'aviation arctique, le Norvégien Roald Amundsen et l'Américain Richard Byrd dans les années 1920.
Pour Hubert de Chevigny, qui avait déjà atteint en ULM les pôles Nord magnétique (1982) puis géographique à sa deuxième tentative (1987), cette expédition anachronique avec une montre, un compas solaire, un dérivomètre, deux sextants, marin et à bulle, pour seuls instruments de navigation, s'imposait comme une " porte de sortie " de ses aventures polaires. " Pour mes précédentes expéditions, j'avais étudié la géographie, la météo, les glaces et, surtout, l'histoire de l'Arctique, explique-t-il. Ce cheminement de vingt ans m'a conduit jusqu'à la phase majeure des premières conquêtes aériennes en totale autonomie. Pour en finir avec le pôle, il me restait à écrire cette page. C'était devenu une obsession. "
Si les expéditions de Byrd et d'Amundsen ont été " une source d'inspiration incontestable ", il ne s'agissait pas de faire un remake en recherchant un avion des années 1920 pour partir du Spitzberg. " Le contexte psychologique est très différent, dit-il. A leur époque, il fallait être très courageux pour s'aventurer sur la banquise. Amundsen était un vrai polaire qui avait déjà réussi la conquête du pôle Sud alors que Byrd avait encore la hantise de la glace et n'envisageait même pas de s'y poser. En cas de problème, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. "
Dès lors, le vrai challenge de cette expédition, baptisée Fly Different (voler différemment), était la précision de la navigation astronomique dans une zone où la proximité du pôle magnétique ne permet pas l'utilisation d'un compas magnétique. Pour cet exercice, Hubert de Chevigny a fait appel à Gérard d'Aboville, ami de longue date et familier de l'utilisation du sextant lors de ses traversées à l'aviron de l'Atlantique nord (1980), puis du Pacifique nord, où il avait aussi embarqué l'un des premiers GPS (1991). " Je suis d'une génération qui a utilisé le sextant par nécessité et qui l'utilise à nouveau par plaisir, explique-t-il. Pour moi, c'est une parenthèse plutôt amusante car, avec la proximité du pôle, c'est l'exercice de navigation par excellence dans un monde devenu presse- bouton. "
Avec une position et un cap connus avec précision avant le décollage, l'équipage devait effectuer une navigation à l'estime avec des instruments d'une autre époque dénichés par Hubert de Chevigny dans des casses d'avions. Gérard d'Aboville disposait ainsi d'un ciné-dérivomètre, sorte de périscope inversé fixé dans le plancher de l'avion, qui permet, en connaissant l'altitude, de calculer la vitesse et de mesurer la dérive provoquée par les vents souvent violents en Arctique, à partir de repères pris au sol. Cette dérive est aussitôt corrigée sur le compas solaire qui permet au pilote de maintenir un cap par rapport à l'ombre de l'aiguille projetée sur le compas.
DE L'UTILITÉ DU SEXTANT
La position de l'appareil est calculée en vol grâce à un sextant à bulle (avec horizon artificiel), mais les données de cet instrument, qui fixe la latitude et la longitude, deviennent de plus en plus aléatoires en se rapprochant du pôle à cause des phénomènes de réfraction et de la convergence des méridiens vers le sommet du globe terrestre. Des atterrissages sur la banquise se révèlent nécessaires pour préciser les positions avec le sextant marin ou si les conditions météorologiques ne permettent plus de distinguer le relief ou cachent le soleil.
Les phases d'atterrissage et de décollage sur la glace constituaient l'autre difficulté majeure de l'expédition. " Les hautes pressions exceptionnelles exercées sur le pôle depuis plus d'un mois ont anormalement cassé la glace", expliquait Wayne Davidson qui depuis la station météo de Resolute Bay a vu défiler tous les candidats à l'aventure polaire depuis Jean-Louis Etienne en 1986.
Hubert de Chevigny et Bernard Laferrière, ex-avocat d'affaires, promoteur immobilier et pilote amateur chevronné, se sont associés pour concevoir le Private-Explorer, un avion monomoteur (235 chevaux) ultraléger, doté de capacités d'évolution exceptionnelles à basse vitesse pour faciliter le décollage et l'atterrissage sur de courtes distances. L'espace et l'aménagement intérieur pouvaient le transformer en camp de base en cas de séjour prolongé sur la banquise.
Partis de Resolute Bay lundi 23 avril, à 17 heures locales (minuit à Paris), les trois aventuriers ont fait une escale de ravitaillement à la station météo Eureka, située sur le 80e parallèle. Grâce à une belle fenêtre météo, ils ont pu se poser, mardi à 16 h 20 (heure de Paris), à proximité du pôle. " J'ai passé de longues heures l'oeil vissé sur mon dérivomètre, sur ma montre Sector et sur mes calculs, et suis récompensé, estimait Gérard d'Aboville. Le paysage est somptueux. Autour de la seule glace lisse que nous avons fini par trouver, il y a des gros blocs dans tous les sens et avec cette lumière rasante et les reflets qu'elle engendre, l'endroit est vraiment lunaire ". Après neuf heures passées sur la banquise où Gérard d'Aboville a pu affiner la position (à 64 km) au sextant marin, le Private-Explorer a redécollé pour survoler le pôle et ravitailler à la base russe de Borneo, distante de 160 km, avant de prendre le chemin du retour vers Resolute Bay.
GERARD ALBOUY
Donnons maintenant la parole au principal intéressé l'amiral Richard E.Byrd lui même.
En effet en mettant voici la couverture de l'ouvrage de ce dernier intitulé "Mes explorations" publié en France en 1951, mais aux USA dès 1937, où Byrd s'explique. Les internautes jugeront sur pièces.
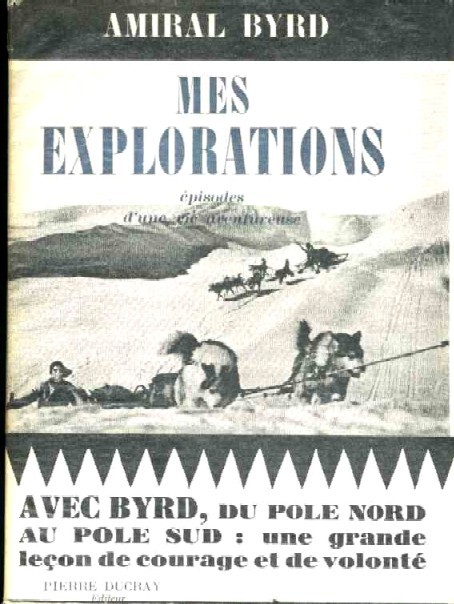
Extrait du livre anglais "Exploring with Byrd" publié à New York by G.P Putmam's Sons en 1937
et traduit en France chez Pierre Ducray Editeur en 1951 sous le titre
"Mes Explorations Episodes d'une vie aventureuse"
et traduit en France chez Pierre Ducray Editeur en 1951 sous le titre
"Mes Explorations Episodes d'une vie aventureuse"
CHAPITRE II
VERS LE POLE NORD
Je fus muté en Nouvelle-Ecosse, où je reçus le commandement de deux camps d'aviation, l'un à North Sydney et l'autre à Dartmouth. Mon travail consistait à effectuer des vols de reconnaissance en vue de rechercher les sous-marins ennemis dans la région nord-ouest de l'Atlantique. Je ne cessai de frapper à la porte de la Direction de l'Aéronautique du Ministère de la Marine pour obtenir la permission de traverser l'Atlantique dans l'un des hydravions de gros tonnage et à grand rayon d'action que la Marine était en train de construire - et ceci sans aucun résultat. Cependant mes recherches dans le domaine de la navigation aérienne me valurent une nomination, à titre de navigateur seulement, sur les hydravions de la Marine américaine qui devaient tenter un raid au-dessus de l'Atlantique. J'accompagnai les appareils pendant les deux premières phases du vol.
Pendant plusieurs années, on me laissa moisir à Washington en qualité d'officier de liaison de la Marine auprès du Congrès. Aussi important et instructif que fût ce poste, il était loin de répondre à mes aspirations. Enfin je reçus l'ordre de me rendre en Angleterre pour embarquer sur le dirigeable ZR-3, qui devait être lancé vers les Etats-Unis. Mais quelques jours après mon arrivée en Angleterre, ce dernier, au cours d'une croisière d'essai, fit explosion au-dessus de l'Humber, provoquant la mort de quarante-cinq hommes. Par miracle, je ne me trouvais pas à mon poste ce jour-là. Au lieu de survoler l'Atlantique, j'eus le triste devoir de rechercher les corps de mes camarades.
Ces déceptions me persuadèrent que ma carrière navale n'aboutirait jamais à des réalisations sérieuses. A mon retour d'Angleterre, j'appris que, comme mes camarades de promotion d'Annapolis, je devais être ramené de mon grade de lieutenant de vaisseau du temps de guerre à celui d'enseigne de première classe. En conséquence, je demandai à être versé dans le cadre de réserve, avec l'espoir qu'il me serait plus facile de réussir une carrière aéronautique dans la vie civile.
Je me tournai alors vers les régions polaires, qui m'avaient depuis toujours irrésistiblement attiré. Avec mon grand ami, le capitaine Bob Bartlett, j'organisai, en 1925, une exploration aérienne au Nord du Groënland. A la requête du Ministère de la Marine, qui devait nous fournir les avions, nous avions joint nos efforts à ceux du commandant Donald B. Mac Millan, qui préparait une expédition semblable à peu près dans la même région. Ce voyage, le premier pour moi vers les régions polaires, fut le plus passionnant qu'on puisse imaginer. I1 m'initia au vol polaire et me valut de faire la connaissance de Floyd Bennett - affecté à notre mission par la Marine en qualité de mécanicien-second pilote - Floyd Bennett, l'un des plus nobles caractères qu'il m'ait été donné de rencontrer parmi les hommes. Tous deux, Bennett et moi, nous fîmes plus de 4.000 kilomètres en avion au-dessus des eaux de l'Ile Cap du Groëland. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée de voir là une performance extraordinaire. Mais le genre d'appareil que nous utilisions, il y a vingt-cinq ans, était, même sous son aspect le plus favorable, une machine incertaine et dangereuse; et quand je pense aux conditions atmosphériques si défavorables dans ces régions, à l'absence de terrains d'atterrissage, aux bourrasques et aux tempêtes de neige subites, j'estime que nous avons eu une chance insensée d'obtenir un pareil résultat sans accident. De plus, nous en avions appris assez, Bennett et moi, pendant cette période d'initiation, pour nous convaincre qu'avec de nouvelles améliorations de la construction aéronautique, un vol au Pôle Nord n'était plus une idée folle, mais un projet raisonnable et réalisable.
Nous avions décidé d'établir cette fois une base au Spitzberg, près de la pointe nord de la Norvège. Cet emplacement, de préférence à beaucoup d'autres, présentait de nombreux avantages. D'abord, moins de 1.200 kilomètres le séparaient du Pôle. Ensuite, dans ces parages, le Gulf Stream commence à entraîner le pack loin de la côte dès le mois d'avril, ce qui signifiait qu'à un moment favorable nous pourrions pénétrer dans Kings-Bay avec un bateau de ravitaillement. A parler vrai, nous réalisions parfaitement les dangers de cette entreprise. De vieux habitués des voyages nordiques nous avaient dit sans fard que nous étions fous. Le brouillard qui s'étend sur l'Océan Arctique ajouterait encore à des risques déjà considérables ; et si notre appareil subissait une avarie, il nous faudrait, disaient-ils, au moins deux ans, à pied, pour regagner la terre, si nous arrivions jamais à l'atteindre. Néanmoins, nous étions prêts à affronter ces périls.
Nos travaux de préparation, à Bennett et à moi, furent loin d'être aussi faciles que nous l'avions espéré. Des obligations de service nous liaient tous deux jusqu'au milieu de janvier 1926. A ce moment-là, le ministre de la Marine Wilbur et l'amiral Moffett nous rendirent notre liberté. Nous allions nobles caractères qu'il m'ait été donné de rencontrer parmi les hommes. Tous deux, Bennett et moi, nous fîmes plus de 4.000 kilomètres en avion au-dessus des eaux de l'Ile Cap du Groëland. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée de voir là une performance extraordinaire. Mais le genre d'appareil que nous utilisions, il y a vingt-cinq ans, était, même sous son aspect le plus favorable, une machine incertaine et dangereuse; et quand je pense aux conditions atmosphériques si défavorables dans ces régions, à l'absence de terrains d'atterrissage, aux bourrasques et aux tempêtes de neige subites, j'estime que nous avons eu une chance insensée d'obtenir un pareil résultat sans accident. De plus, nous en avions appris assez, Bennett et moi, pendant cette période d'initiation, pour nous convaincre qu'avec de nouvelles améliorations de la construction aéronautique, un vol au Pôle Nord n'était plus une idée folle, mais un projet raisonnable et réalisable.
Nous avions décidé d'établir cette fois une base au Spitzberg, près de la pointe nord de la Norvège. Cet emplacement, de préférence à beaucoup d'autres, présentait de nombreux avantages. D'abord, moins de 1.200 kilomètres le séparaient du Pôle. Ensuite, dans ces parages, le Gulf Stream commence à entraîner le pack loin de la côte dès le mois d'avril, ce qui signifiait qu'à un moment favorable nous pourrions pénétrer dans Kings-Bay avec un bateau de ravitaillement. A parler vrai, nous réalisions parfaitement les dangers de cette entreprise. De vieux habitués des voyages nordiques nous avaient dit sans fard que nous étions fous. Le brouillard qui s'étend sur l'Océan Arctique ajouterait encore à des risques déjà considérables ; et si notre appareil subissait une avarie, il nous faudrait, disaient-ils, au moins deux ans, à pied, pour regagner la terre, si nous arrivions jamais à l'atteindre. Néanmoins, nous étions prêts à affronter ces périls.
Nos travaux de préparation, à Bennett et à moi, furent loin d'être aussi faciles que nous l'avions espéré. Des obligations de service nous liaient tous deux jusqu'au milieu de janvier 1926. A ce moment-là, le ministre de la Marine Wilbur et l'amiral Moffett nous rendirent notre liberté. Nous allions cette fois agir pour notre propre compte. Nous n'avions pas osé demander le patronage officiel de la Marine pour une expédition aussi hasardeuse. Nous fîmes face à des difficultés renouvelées qui, cependant, ne s'opposèrent pas, enfin, au départ.
Après avoir mûrement. réfléchi sur notre propre expérience et sur les opinions émises par les experts aéronautiques, nous avions fait choix pour notre raid d'un monoplan trimoteur Fokker.
Un appareil de ce type, qui comptait déjà 32.000 kilomètres de vol, se trouvait alors disponible. Sa puissance était de 200 CV; il avait des moteurs Wright, à refroidissement par air, dont deux, indifféremment, pouvaient maintenir l'appareil en vol (à condition que la charge ne soit pas trop lourde) si le troisième flanchait. C'était là, naturellement, une chance de succès de plus.
L'avion avait un fuselage de 13 mètres de long et une envergure de 20 mètres. Deux réservoirs à essence de 450 litres étaient fixés dans chaque aile, et deux autres, contenant chacun 500 litres, dans le fuselage. L'essence supplémentaire, dont nous pourrions avoir besoin, serait transportée dans des bidons de 22 litres placés également dans le fuselage.
En l'honneur de la fille de mon ami Edsel Ford, nous avions baptisé l'appareil : Josephine Ford. Il fut soigneusement essayé avant notre envol. Sa consommation de carburant, à la vitesse de croisière, était d'environ 120 litres à l'heure, c'est-à-dire inférieure à celle que nous avions prévue - nouvel encouragement. Il était capable d'atteindre une vitesse de 190 kilomètres à l'heure.
Grâce à la générosité de la Commission Maritime, le steamer Chantier fut mis à ma disposition. Il jaugeait environ 3.500 tonnes, et notre avion y serait au large.
L'expédition comptait une cinquantaine de membres, presque tous volontaires, tous jeunes et aventureux. J'en avais pris un certain nombre dans le cadre de réserve de la Marine, parmi les hommes qui avaient déjà fait seize ou vingt ans de service ; pour les autres, j'avais opéré une sérieuse sélection entre les milliers de volontaires.
Après des mois de dur labeur, nous quittions enfin NewYork, le 5 avril 1926, avec nos cinquante hommes et six mois de vivres. Entre parenthèses, je crains bien que le capitaine Brennan et ses trois camarades de la Marine marchande ne se soient pas sentis particulièrement rassurés (quoiqu'ils n'en aient rien laissé paraître) en se voyant embarqués pour une croisière de 16.000 kilomètres avec un équipage composé en grande partie de marins d'eau douce.
Nous avons atteint Kings-Bay et le Spitzberg à 4 heures de l'après-midi le 29 avril, et nous y trouvâmes les membres de l'expédition Amundsen-Ellsworth-Nobile se préparant à recevoir le grand dirigeable italien Norge qui devait bientôt quitter l'Italie pour voler vers le Pôle.
Le sort n'a pas tardé à mettre de sérieux obstacles sur notre route. Le petit port de Kings-Bay, était bloqué par les glaces, mais l'habileté du capitaine Brennan réussit à mettre le Chantier à l'ancre à moins de 800 mètres du rivage.
A ma grande consternation, je découvris que j'aurais beaucoup de difficultés à amener au sol ma lourde machine. J'avais compté sur le bassin du port à charbon. Une enquête préalable m'avait appris qu'à cet endroit l'eau était assez profonde pour notre steamer, et quant à l'autorisation, il suffisait de la demander à l'administrateur du lieu.
Or nous avons trouvé en ce seul point possible de débarquement une petite canonnière norvégienne, le Heimdahl, qui prenait du charbon. Bien entendu, j'ai immédiatement demandé si nous pourrions disposer du bassin pour quelques heures au moins.
- Bien au regret, mais notre bateau a failli disparaître en mer, il y a quelques jours, me fut-il répondu. Les glaces flottantes l'ont cerné et entraîné vers la terre malgré tous nos efforts.
Je connaissais le danger de l'ice-pack, et, évidemment, il était inutile de discuter.
La seule solution était de mettre le à l'ancre le plus près possible du rivage et de lancer notre avion à travers les glaçons à la dérive sur une sorte de radeau. Quand les Norvégiens eurent connaissance de ce projet, il nous pressèrent de l'abandonner.
- Vous ignorez tout de la glace - tel était le leit-motiv de leurs avertissements - sans quoi vous ne tenteriez pas une chose pareille. Vous pouvez être sûrs que le pack se mettra en mouvement avant que vous puissiez atteindre le rivage.
En posant de lourds madriers en travers des fargues de nos quatre baleinières, l'équipage construisit un grand radeau. Le steamer se trouvait du même coup démuni de canots, et cela ne me plaisait guère, à cause de la constante menace du pack. Il commença à neiger, et nous nous sentions pénétrés d'un froid âpre tandis que nos mains travaillaient activement.
En pleine rafale de neige, le second, de Lucca, dégagea le fuselage de la Josephine Ford de ses cales à bord du Chantier et, avec adresse, l'amena sans dommages sur le radeau. Juste à ce moment-là, un changement de la marée commença à refermer le passage que nous avions ouvert au milieu des lourdes masses de glace qui obstruaient le chemin du rivage. Cependant, sans se laisser décourager, nos hommes poursuivirent leurs efforts et parvinrent à assujettir la lourde masse de l'engin sur son fragile support.
Nous courions là un danger effrayant, car si le moindre souffle de vent s'était élevé, le radeau aurait été mis en pièce ou entraîné vers la mer. C'était ou bien le débarquement de notre équipage et de notre matériel à terre ou le retour ignominieux aux Etats-Unis dans la honte de l'échec. Nous préférions tout risquer pour réussir plutôt que d'admettre lâchement cette dernière éventualité.
A l'instant précis où nous terminions le radeau, ce que nous redoutions se produisit. La glace commença à se déplacer avec une grande force, et nous dûmes livrer un combat de haute lutte pour sauver le radeau et même le steamer. Nous nous sommes tout à coup trouvés face à face avec un énorme iceberg que la neige nous avait caché. Il menaçait le gouvernail de notre bateau et il a fallu dynamiter un coin du monstre et le réduire en glaçons assez petits pour être balayés par le courant.
J'ai poussé un grand soupir de soulagement quand nous avons enfin atteint la glace qui recouvrait le rivage. Le ciel était avec nous, c'était certain.
Cependant, nous avions d'autres soucis. Personne ne savait comment un appareil comme la Josephine Ford se comporterait sur des skis. Nous n'étions pas au bout de nos peines.
L'extrémité du terrain d'atterrissage se trouvait à environ 1.500 mètres du bord du rivage glacé. Si amener l'appareil à terre représentait pour les hommes une entreprise considérable, il n'était pas moins difficile de hisser à la fois l'avion et le matériel au sommet d'une longue pente à travers une neige épaisse et par 15° sous zéro.
Ne disposant pas d'une surface assez unie pour décoller avec une lourde charge, nous avons été obligés d'essayer une autre combinaison : effectuer le décollage le long d'une piste en pente légère. Aplanir la surface du runway fut le plus gros travail. Les hommes y étaient attelés dix-huit heures par jour, mais je n'ai jamais entendu une seule plainte.
La première tentative de départ pour un vol d'essai s'est terminée dans un tas de neige. Résultat : un ski en pièces et le train d'atterrissage brisé.
Malgré ces déboires, les hommes n'ont pas perdu courage. Deux fois encore nous avons essayé de partir, en endommageant chaque fois un ski de la même façon. Si c'était là ce que nous réussissions de mieux avec une charge légère, comment soulèverions-nous jamais le poids polaire de quatre tonnes et demie ?
Noville, Mulroy et "Chips" Gould, le charpentier, passèrent deux jours et deux nuits à faire de nouveaux skis. Ne pouvant se procurer d'autre bois dur, ils renforcèrent les skis avec les avirons des canots de sauvetage du Chantier. Profitant de notre première expérience, nous fartâmes les skis avec un mélange de résine et de goudron. Pour le deuxième essai, le runway était bien lisse et l'avion légèrement chargé. Nos cœurs battaient.
Cette fois, le Josephine Ford se lança à vive allure, puis prit un essor plein de grâce. Portant à son bord les lieutenants Noville et Parker, sans compter Bennett, il effectua un vol de plus de deux heures, avec une consommation minime. Nos craintes concernant le fonctionnement défectueux des moteurs dans une atmosphère glacée se révélèrent absolument sans objet, et nos prévisions les plus optimistes furent dépassées.
Le 8 mai, les derniers préparatifs étaient terminés. Le météorologiste Haines nous prévint que les conditions atmosphériques étaient parfaites.
Nous avons fait tourner les moteurs pour les réchauffer. Après avoir dégelé l'huile, nous mîmes la dernière main au transport du carburant et des vivres, et nous passâmes une dernière inspection des instruments. Puis Bennett et moi, nous grimpâmes sur nos sièges, et en route !
En route, oui, mais hélas ! pas en l'air. Notre chargement s'avérait trop lourd, la couche de neige n'était pas assez lisse, le frottement des skis freinait considérablement notre élan. L'avion, simplement, refusait de décoller. Notre descente le long du runway, à une vitesse effrayante, en cahotant sur la surface tourmentée de la piste, se termina dans un tas de neige. L'appareil faillit se retourner.
Une douzaine d'hommes arrivèrent, épuisés, navrés, incapables de dire un mot ! Ils avaient travaillé presque jusqu'à la limite de leurs forces pour nous donner toutes nos chances de réussite. Je me suis frayé difficilement un passage à travers la neige épaisse vers le train d'atterrissage de bâbord. Miracle ! Il était indemne, ainsi que le ski. Je suis passé de l'autre côté, et j'ai constaté la même absence de dégâts.
Alors ma crainte s'est transformée en joie : car si le train d'atterrissage supportait ce choc, j'étais sûr que nous pourrions, un jour ou l'autre, prendre la route du Pôle avec assez de carburant pour l'aller et le retour.
Avec des bêches et des pelles, nous avons dégagé l'avion enseveli dans la neige et nous avons remonté la pente pour tenter un nouvel essai. Après un autre conciliabule, nous décidâmes de consacrer la nuit à prolonger et aplanir le runway. De plus, pour réduire le chargement, nous jetâmes par-dessus bord le matériel et le carburant qui ne nous étaient pas indispensables.
Le beau temps se maintenait ; il fallait partir le plus près possible de minuit, à l'heure où le froid de la nuit, en durcissant la neige, faciliterait le glissement des skis. A minuit et demi (heure de Greenwich), tout était prêt. Bennett et moi avions à peine dormi depuis trente-six heures, mais cela nous importait peu.
La piste fut soigneusement glacée sur le trajet des skis, pour que notre départ soit plus rapide, tandis. que Bennett et Kinkaid mettaient les moteurs en route.
Bennett vint nous dire un dernier mot, et nous prîmes ensemble la décision de risquer le tout pour le tout au départ. Nous donnerions au Josephine Ford toute sa puissance et toute sa vitesse, et nous nous envolerions ou nous irions nous écraser sur les arêtes vives de la glace à l'autre bout du runway.
C'est avec une charge totale d'environ cinq tonnes que nous sommes descendus à fond de train le long de la piste. Au moment précis où il semblait que nous allions nous précipiter contre les aspérités qui nous menaçaient, Bennett, tirant violemment sur le manche à balai, redressa l'appareil qui se décida enfin à prendre son vol.
Depuis des mois, une attention extrême avait été apportée à chacun des détails qui assureraient notre salut s'il nous arrivait un accident. En cas d'atterrissage forcé, nous avions un appareil de radio à ondes courtes, fonctionnant avec une dynamo à main. Un traîneau, cadeau d'Amundsen, était fixé dans le fuselage. Il était destiné à porter des vivres et des vêtements, si nous étions obligés de regagner le Groënland à pied. Nous avions dix semaines de vivres.
Nos premières évolutions nous permirent de repérer les abords familiers de Kings-Bay. Nous montâmes à six cents mètres pour jouir de la vue de la côte et des splendides montagnes couvertes de neige qui s'étendaient vers l'intérieur. Moins d'une heure après avoir décollé, nous franchissions la limite de l'ice-pack polaire. La terre en était beaucoup plus proche que nous ne l'avions cru.
Devant nous, la mer couverte de glace brillait sous les rayons du soleil de minuit, déesse fascinante qui, à l'instar de Rana, la ravisseuse scandinave, avait, par sa séduction, attiré dans son étreinte meurtrière tant d'hommes à jamais disparus. Quelle ivresse de penser que, pour la première fois, deux mortels, grâce à leur avion, avaient le privilège de contempler ses charmes et de découvrir ses secrets, hors de la portée de son maléfique pouvoir .
Atteindre le Pôle était le but de notre entreprise, mais c'était aussi une question vitale pour nous. Nous ne pouvions regagner le Spitzberg sans connaître notre position exacte. I1 nous fallait consacrer toute notre attention et chaque seconde de notre temps à maintenir notre cap.
Derrière nous, les montagnes scintillaient dans le soleil à moins de 150 kilomètres. C'était notre dernier lien avec la civilisation. L'inconnu s'étendait devant nous.
Bennett et moi pilotions à tour de rôle. Pour une raison inexplicable, l'avion avait tendance à virer vers la droite. Par une porte d'accès au poste de pilotage, Bennett pouvait me voir travailler. A chaque instant, il me regardait pour obtenir confirmation du cap. S'il lui arrivait de s'en écarter, je lui faisais signe de la main d'aller vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit revenu dans la bonne direction, qui m'était indiquée par l'astrocompas. Quand c'était à moi de veiller à la navigation, je rectifiais la dérive toutes les trois minutes et je mesurais la vitesse par rapport au sol, de sorte qu'en cas de changement dans le vent, j'aurais pu le déceler immédiatement et y remédier.
Nous avions trois paires de gants que je changeais constamment suivant le travail que je faisais et que j'enlevais quelquefois tout à fait pendant quelques instants pour écrire ou tracer des graphiques sur la carte. Je me suis gelé la figure et une main à regarder avec les instruments par les hublots, mais je l'ai senti immédiatement, et j'ai pris plus de précautions par la suite. Ordinairement, une gelure n'est pas dangereuse si elle est décelée à temps et si on rétablit aussitôt la circulation en frictionnant les parties atteintes. Nous avions aussi avec nous des casques de cuir qui nous couvriraient entièrement le visage si cela devenait nécessaire.
Une fois assuré de notre cap, j'ai pu consacrer toute mon attention à l'ice-pack, qui m'avait, dès ma jeunesse, si vivement intrigué. Nous volions à environ 600 mètres, et mon rayon visuel s'étendait sur 80 kilomètres dans toutes les directions. Je ne distinguais rien qui ressemblât à la terre. Le pack était recouvert d'un réseau d'arêtes dues aux pressions internes, mais par endroits, on apercevait des surfaces qui paraissaient assez longues et assez lisses pour qu'on y puisse atterrir. Cependant, vue de si haut, la glace est terriblement trompeuse.
Sachant que c'était là un point capital pour tous ceux qui envisageraient une entreprise comme la nôtre, j'ai étudié ensuite la nature des vents. Ils se sont révélés de vitesse très modérée car, ainsi que nous l'avions prévu, la surface unie de la glace et la température arctique ne se prêtent pas à la formation de courants aériens violents, tels qu'or. en rencontre dans les autres régions de la terre. Par exemple, je ne pourrais dire, ne l'ayant fort heureusement pas expérimenté, quelles modifications le blizzard arctique aurait apporté aux conditions atmosphériques. Pour nous, nous étions encore favorisés par le printemps polaire et le jour de vingt-quatre heures.
I1 était temps de relayer Bennett au manche à balai, non seulement pour qu'il puisse détendre ses jambes, mais aussi pour qu'il verse dans les réservoirs l'essence contenue dans les bidons de vingt-deux litres entassés dans la carlingue. Les récipients vides étaient lancés ensuite par-dessus bord, pour nous décharger de leur poids, si léger qu'il fût.
A un moment donné, en me retournant, je sentis quelque chose de dur dans ma poche intérieure gauche et je me souvins qu'elle était pleine de porte-bonheur. Je ne suis pas superstitieux, il me semble, mais on n'a jamais vu un explorateur partir sans amulettes. Dans le nombre, se trouvait une médaille pieuse donnée par un ami. Elle appartenait à sa fiancée, et il croyait fermement qu'elle me ramènerait sain et sauf après l'accomplissement de ma mission. Il y avait aussi un minuscule fer à cheval, forgé par un célèbre maréchal-ferrant, et, attachée dans ma poche, une petite pièce de monnaie que Peary avait portée sur lui, épinglée à sa chemise, au cours de son voyage au Pôle Nord.
Nous pénétrions maintenant dans des régions que nul oeil mortel n'avait jamais contemplées. Oubliant les jouissances de l'aviation, je goûtais pleinement celles de l'explorateur. J'expérimentais ce sentiment d'exaltation à nulle autre pareille qu'on éprouve en plongeant ses regards sur des étendues vierges. Ces instants me payaient largement de toutes mes peines.
Notre but était là, de l'autre côté de la scintillante blancheur de l'horizon. Dans la griserie de la découverte, nous survolions ces terres nouvelles à une cadence de 10 000 milles carrés à l'heure. Pendant quelques minutes, j'ai cru discerner les pics neigeux d'une lointaine montagne. Mais ce n'était qu'une ligne de nuages flottant bas sur le ciel.
Quelque part vers la droite, les rayons du soleil de minuit illuminaient le théâtre des combats héroïques que Nansen avait livrés pour atteindre l'objectif dont nous approchions à une vitesse de 160 kilomètres à l'heure. A notre gauche, Peary avait passé, une vingtaine d'années auparavant.
Alors que nous pensions, d'après nos calculs, nous trouver environ à une heure du Pôle, je me suis aperçu, par la fenêtre de la carlingue, qu'il y avait une fuite au réservoir d'huile du moteur de tribord. Bennett m'écrivit un billet : «Ce moteur va s'arrêter ». Lui, Bennett, était d'avis de tenter de nous poser pour réparer cette avarie, mais nous avons fini par décider de continuer jusqu'au Pôle. Un atterrissage n'y serait certes pas plus dangereux qu'à l'endroit où nous étions.
J'ai repris le manche à balai, mais je ne pouvais détacher mes yeux de cette fuite, ni de l'indicateur de pression d'huile. Si la pression baissait, nous pouvions faire notre deuil du moteur. J'étais sûr que ce désastre allait se produire d'un moment à l'autre, mais il n'était plus temps de revenir en arrière.
Le 9 mai 1926, à 9 h 02, heure de Greenwich nos calculs nous ont appris que nous avions atteint le Pôle. Le rêve d'une vie était enfin réalisé.Nous avons viré vers la droite, puis vers la gauche, pour mesurer la hauteur du soleil à l'aide du sextant et confirmer ainsi notre position.
Nous avons pris ensuite des photos et des films de la région survolée, puis, après avoir parcouru plusieurs kilomètres en sens inverse, nous avons décrit un autre circuit de plus grand rayon, pour être sûrs d'avoir réellement encerclé le Pôle géographique. Ainsi, quelques minutes nous avaient suffi pour faire le tour du monde. Nous avions, pendant ce temps, perdu un jour entier que, naturellement, nous avons retrouvé une fois le cercle bouclé.
Deux questions angoissantes se posaient alors à nous : Etions-nous exactement à l'endroit où nous croyions être? Sinon - et comment s'en assurer de façon certaine ? - nous manquerions le Spitzberg. D'autre part, même si nous ne déviions pas de notre cap et n'avions pas d'ennuis de ce côté, qu'arriverait-il si ce damné moteur s'arrêtait ?
Tout en volant ainsi au-dessus du sommet du globe, nous rendions un fervent hommage à l'héroïque Peary, et nous vérifiions chaque détail de son carnet de route.A 9 h. 15, nous mîmes le cap sur le Spitzberg, abandonnant, à cause de la fuite d'huile, le projet de revenir par le cap Morris Jesup. Le sentiment de détente résultant de l'accomplissement de notre mission, joint à l'effet soporifique du ronronnement des moteurs, nous, portait à une dangereuse somnolence. J'ai failli m'endormir aux commandes, et j'ai dû plusieurs fois remplacer Bennett qui en faisait autant.
Voici un extrait du message que j'ai câblé aux Etats-Unis en faisant route vers Kings-Bay :
" Le vent s'est mis à fraîchir et à changer de direction peu après notre départ du Pôle, et bientôt nous avions dépassé 160 kilomètres à l'heure.
A n'en pas douter, les éléments souriaient ce jour-là -à ces deux chétifs mortels qui, dans leur minuscule machine, s'aventuraient courageusement au-dessus de ces immenses solitudes glacées.
Nous avions conscience de ne pas tenir plus de place que deux atomes perdus dans un univers de blancheur. Nous nous sentions aussi isolés qu'un mort dans sa tombe, aussi lointains qu'une étoile dans les hauteurs du ciel.
Ici, dans un autre monde, loin de la multitude des hommes, les petitesses de la vie se détachaient comme un manteau de nos épaules. Nous n'éprouvions ni l'émotion que nous aurions crue inséparable de la réussite, ni la moindre crainte de la mort qui nous menaçait de toutes parts. Au lieu de cela, nous avions l'impression d'être devenus presque immatériels, désincarnés. Nous allions, nous allions toujours. Il nous semblait que nous ne pourrions jamais nous arrêter.
Notre grande vitesse stimulait si fort notre activité mentale qu'une minute nous faisait l'effet d'un quart d'heure. J'ai mesuré pleinement alors ce que signifie la relativité du temps "
Nous visions Grey-Point, au Spitzberg, et, quand nous l'avons aperçu devant nous, nous nous sommes rendus compte que nous avions réussi à maintenir rigoureusement notre cap. Nous nous trouvions exactement à l'endroit prévu.
Pendant ce temps, à. notre grande surprise, un miracle s'était produit. Le fameux moteur tournait toujours. Il y a cependant quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent pour qu'une fuite de ce genre amène une panne de moteur, généralement par la rupture d'une canalisation d'huile. Nous avons découvert plus tard que cette fuite était causée par le jeu exagéré d'un rivet dans son trou. Quand le niveau de l'huile devint inférieur à celui du trou, la fuite cessa. Heureusement, Noville avait mis un supplément d'huile dans un réservoir de secours.
C'était un soulagement merveilleux de ne plus avoir à faire notre navigation. Nous sommes entrés dans Kings-Bay en volant à une altitude d'environ 1.200 mètres. Quel plaisir de revoir notre petit village et, plus encore, le bon vieux Chantier qui paraissait lilliputien, là-bas en dessous. Avec, j'en étais sûr, un sifflement de joie, il nous envoyait sa vapeur pour nous souhaiter la bienvenue.
En regagnant New-York, j'ai envoyé par radio un message demandant qu'un officier de liaison du Ministère de la Marine vienne chercher mes cartes et mes rapports. Ce qui fut fait. Par l'intermédiaire du ministre, l'ensemble des pièces fut présenté à la Société Nationale de Géographie, puis remis à une commission spéciale de cette société, composée de son président, M. Gilbert Grosvenor, du président de sa Commission de recherches, M. Frederick Coville et du colonel E. Lester Jones, membre du conseil d'administration, qui était aussi directeur du Commissariat général du Contrôle géodésique et côtier des Etats-Unis.
Cette commission désigna une sous-commission d'experts mathématiciens. Le rapport final fut soumis au ministre de la Marine. Il comprenait, entre autres, le passage suivant :
"Nous avons l'honneur de présenter le rapport suivant concernant le Rapport sur la navigation aérienne d'un vol au Pôle établi par le capitaine de corvette Richard Evelyn Byrd .Nous avons soigneusement étudié les notes de l'auteur, relatant ses observations pendant son trajet aller et retour au Pôle... Nous avons vérifié tous ses calculs. Nous avons également fait un examen satisfaisant du sextant et de l'astrocompas employés par le capitaine de corvette Byrd .
. Nous estimons qu'à près de 9 heures 3 minutes, heure de Greenwich, le 9 mai 1926, dans la mesure où un observateur en avion est certain de sa position, après l'avoir déterminée par les méthodes les plus exactes et les instruments les plus précis, le capitaine de corvette Richard Evelyn Byrd peut justement affirmer avoir survolé le Pôle Nord."
Fin du chapitre du livre de Byrd
III Conclusion.
Comme vous le voyez, ce sont les travaux des organismes et des personnes comme la Société Nationale de Géographie, puis la commission spéciale de cette société, composée de son président, M. Gilbert Grosvenor, du président de sa Commission de recherches, M. Frederick Coville et du colonel E. Lester Jones, membre du conseil d'administration, qui était aussi directeur du Commissariat général du Contrôle géodésique et côtier des Etats-Unis, qui sont mis en accusation par les détracteurs de Byrd. A vous de savoir désormais qui est dans le vrai....
Mais comme vous devez le savoir, il y a aussi cette polémique lancée à propos du fameux carnet de bord attribué à cet amiral Byrd, concernant son vol vers le Pôle Sud, le 19 Février 1947
Vous en trouverez les éléments principaux sur notre page:
...En plus on a constaté, que le style du texte ne semble pas correspondre aux propos d'un amiral des USA.
Article mis en page le 05/05/04 , et revu le 02/06/05, puis le 23/08/05, puis le 17/05/08.
IDYLLE Fred